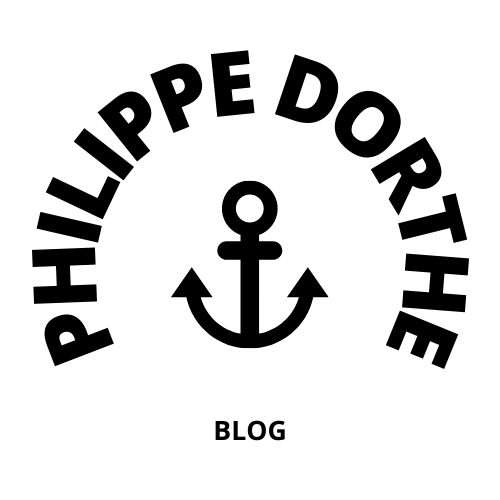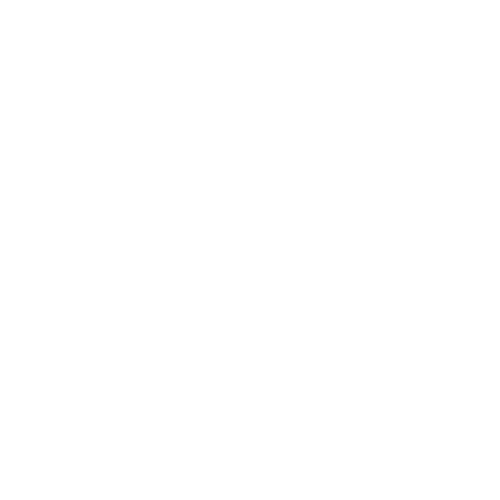Propos recueillis par Michel Revol

Stéphane Le Foll, maire du Mans, ancien Ministre de l’Agriculture
« C’est le gag de l’histoire. » En 2006, c’est dans sa ville du Mans que la FNSEA, le principal syndicat agricole, décide d’une nouvelle orientation économique, et presque politique : le chef d’une exploitation agricole doit travailler comme un chef d’entreprise. Son objectif, c’est désormais la rentabilité, donc la spécialisation des cultures et la recherche de capitaux pour investir toujours plus et dégager des marges. Ce système, assure Stéphane Le Foll, fait fausse route. Il est même à bout de souffle, dit-il. L’ancien ministre de l’Agriculture de François Hollande explique en partie la crise qui traverse, aujourd’hui, le monde agricole et conduit à la colère du moment. Il voit, évidemment, d’autres causes à cette colère, comme la taxation sur le gasoil non routier, la baisse des prix ou encore le réchauffement climatique qui bouleverse les cycles de la nature. Mais l’enfant de paysans bretons milite pour un retour à une agriculture raisonnée, fondée sur les cycles de la nature et le retour au collectif. Il s’en explique en exclusivité pour Le Point.
Le Point : La France est coutumière des crises agricoles, déclenchées la plupart du temps par les mêmes causes : les prix trop bas, les normes envahissantes ou encore les taxes trop lourdes. 2024 est-elle une année différente des autres ?
Stéphane Le Foll : On est habitué à ces mouvements de colère, mais celui-ci est différent. D’abord, il y a un contexte plus général. La crise est partie des Pays-Bas, puis s’est propagée en Allemagne avant d’atteindre la France. Ce n’est donc pas, comme souvent, une crise de marché national. J’en ai connu cinq ou six, sur le lait, le porc, la viande bovine… Lors de la crise du porc en 2014 et en 2015, le prix du kilo était de 1,02 euro, mais il est monté ensuite jusqu’à 2,10 euros. Ce prix baisse aujourd’hui, alors qu’en même temps les agriculteurs font face à une hausse des charges, avec notamment l’envolée du coût de l’énergie. Il s’y ajoute la fin de la détaxation du gasoil non routier. Les agriculteurs disent donc : « Nos prix de vente baissent, nos charges augmentent, et en plus le gouvernement ne trouve rien de mieux à faire que réintroduire la taxe sur le gasoil ! » C’est une crise anticipatrice : les agriculteurs voient venir un effet de ciseau entre baisse des prix et hausse des charges.
Il y a d’autres éléments, comme la surabondance des normes françaises et européennes, les accusations de pollution…
C’est vrai. N’oublions pas les aléas climatiques qui réduisent la production. C’est le cas dans le Sud-Ouest, avec la sécheresse et le réchauffement climatique, et dans le Nord et le Pas-de-Calais avec les inondations. Mais, plus largement, nous assistons à une crise morale et politique, au sens noble du terme. Elle porte sur la place que les agriculteurs occupent dans la société. Ils se sentent culpabilisés, même si tout le monde les aime ! En fait, ils ne savent pas où les pouvoirs publics les emmènent. Les normes s’empilent, mais aucun cap n’est donné. On n’en identifie pas dans les dernières négociations, comme celles de la PAC ou du Pacte vert européen. La réglementation de l’Union européenne reprend ce qui existait déjà, mais renvoie aux États l’obligation de proposer des cadres environnementaux spécifiques. Les agriculteurs ne savent pas ce que veut l’Europe ni la France. Dans le domaine agricole, elle ne porte qu’une seule loi, la loi Egalim, qui ne traite que d’une chose : les prix et la relation avec la grande distribution. Or le problème est plus global, en particulier sur la question du rapport entre production et environnement.
La France, malgré ses élans d’amour pour l’agriculture, n’aborderait donc pas le problème par le bon bout ?
On avance par grands interdits sans aucune méthode et aucun projet. Le cœur du sujet est là. Les agriculteurs le perçoivent très bien. L’agriculture est devenue un impensé sans ambition. Il n’y a aucune ambition agricole européenne ni française. Où sont le cap et la cohérence quand Emmanuel Macron s’engage sur la fin du glyphosate, mais laisse deux ans plus tard la France s’abstenir lorsque l’Europe décide le retour de ce même glyphosate ? On n’y comprend plus rien. J’avais dit à l’époque : « Il ne faut pas interdire mais baisser l’utilisation et chercher des alternatives. » Macron, lui, dit : « On interdit puis on laisse faire l’Europe. » Tout cela crée un contexte explosif.
L’UE est pourtant généreuse avec la France. Notre pays est celui qui reçoit le plus de subventions agricoles, avec un peu plus de 9 milliards d’euros déversés chaque année…
Au-delà du fait qu’elle met de l’argent, l’Union européenne doit dire que l’agriculture est une activité de production, mais de production durable. Il faut faire évoluer notre modèle. L’agriculture ne doit pas être la variable d’ajustement d’accords commerciaux internationaux, et encore moins subir ses effets collatéraux. La fin de l’OMC a signé celle d’un espace pour des négociations internationales. Tout se passe désormais en bilatéral, au détriment de l’agriculture. Le résultat, c’est qu’on échange des voitures ou des services financiers contre certains produits agricoles, comme les céréales, la viande bovine et la volaille. On a complètement changé de paradigme, et il est très défavorable à l’agriculture européenne. L’Europe a en effet un problème compétitif structurel, lié à ses normes environnementales et sociales, mais aussi à la pression sur le foncier. Il est beaucoup plus rare, donc coûteux, qu’ailleurs dans le monde, en Argentine ou au Brésil, par exemple !
L’agroécologie est le meilleur moyen de produire sans aller chercher sans cesse de la rentabilité.
Comment le modèle français doit-il évoluer ?
Le gouvernement ne dit rien sur l’avenir de l’agriculture. Or, il me semble indispensable de porter l’idée d’un modèle environnemental. On n’en a pas pris le chemin. En 2006, au congrès du Mans, la FNSEA édicte que les chefs d’exploitation sont devenus des chefs d’entreprise. Si on suit cette idée, ils doivent donc raisonner comme un patron, avec une relation capital-travail traditionnelle et la nécessité, pour faire tourner l’entreprise, d’aller chercher des capitaux pour investir. Mais l’agriculture a une caractéristique majeure : elle est confrontée au vivant et aux sols, ce qui n’est pas le cas des autres activités économiques. Ce système conduit à se spécialiser et à produire beaucoup en agrandissant les surfaces, en achetant du matériel, des bâtiments, des phytosanitaires. Les besoins de financement ne cessent d’augmenter, il faut donc de la rentabilité pour les rémunérer. Les agriculteurs ne vont pas chercher des capitaux à la Bourse mais à la banque, ils empruntent, il faut ensuite rembourser. Mais une ferme, ce n’est pas une start-up. La bonne stratégie n’est pas de poursuivre cette logique capitalistique. Je crois qu’on arrive au bout de ce modèle de spécialisation.
Quel modèle préconisez-vous ?
Je porte comme projet l’agroécologie, je l’ai défendue en tant que ministre de l’Agriculture. Avec un principe : plutôt que d’augmenter sans cesse le besoin en capital, utilisons d’abord ce que les écosystèmes et la nature nous fournissent gratuitement. C’est le meilleur moyen de continuer à produire en polluant moins et sans chercher sans cesse à augmenter le besoin en capital.
C’est-à-dire ?
Si l’agriculteur se spécialise dans la culture du blé pour obtenir plus de rentabilité, il doit augmenter son rendement et limiter ses rotations. Il faut au contraire augmenter les rotations pour pouvoir augmenter le rendement. Il est donc plus judicieux d’utiliser le cycle de production d’un sol d’une manière continue pour maximiser en particulier l’énergie solaire, car la plante, c’est de la photosynthèse. Si on a cultivé du blé, on peut ensuite faire comme autrefois de la luzerne, qui permet de fixer de l’azote et donc d’acheter moins d’engrais. En utilisant la même énergie solaire, on peut faire deux, voire trois productions, au lieu d’une. Avec des rotations plus importantes, on baisse aussi les besoins en phytosanitaire.
Vous aviez lancé, lorsque vous étiez ministre, les Groupements d’intérêt économiques et environnementaux (GIEE), qui avaient pour principe de rassembler plusieurs exploitations et partenaires pour un projet agricole plus efficace et respectueux de l’environnement. C’était aussi une parade au patron d’exploitation « chef d’entreprise » ?
Oui. De plus en plus, l’entreprise individuelle prime, alors que l’agriculture, depuis le début, a toujours été une recherche d’équilibre entre le paysan-individu et l’entraide collective. Les Gaec, les coopératives, tout cela a été inventé par les agriculteurs. On l’a oublié. C’est dans cet esprit que j’ai lancé en 2014 ces groupements. Ils permettent de mutualiser des coûts, donc d’avoir une meilleure rentabilité et d’intégrer les rotations sur des surfaces plus importantes et partagées. La performance économique est au service d’un collectif et d’une ambition écologique. Car, contrairement aux écologistes, je n’ai jamais opposé rendements et environnement. Un agriculteur doit vivre de son métier, c’est pour cela qu’il faut un projet ambitieux pour accompagner ce changement de modèle. Aujourd’hui, plus de 12 000 exploitations sont regroupées en 752 GIEE, capables d’assumer de manière collective les défis qui se posent aux agriculteurs.
Vous accusez les syndicats, comme la FNSEA, de militer pour un modèle à vos yeux dépassé ?
Le syndicat majoritaire a une ligne et c’est pour cela que nous avons eu des divergences. On ne peut plus se contenter de reporter la responsabilité des crises sur l’Europe, sur la grande distribution, sur l’industrie agroalimentaire. Il faut faire un choix de projet. Ce qui n’a pas été fait depuis sept ans. On a besoin d’une agriculture forte, organisée, avec une feuille de route.