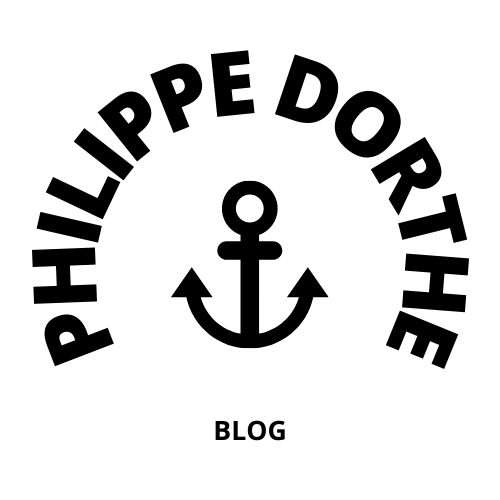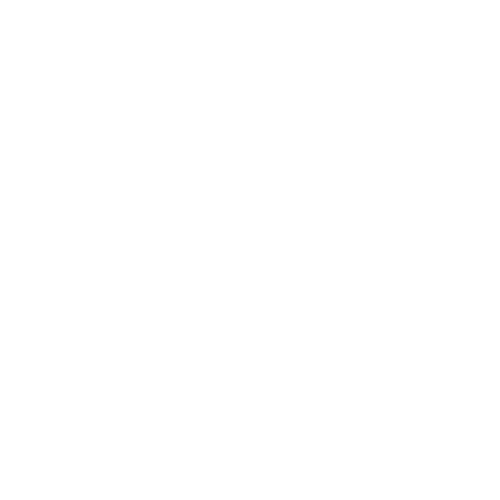Écrire l’avenir de la gauche
Par Stéphane LE FOLL

Ministre de l’Agriculture de 2012 à 2017, porte-parole du gouvernement à partir de 2014, il a été élu maire-président de Le Mans métropole en 2018.
Il est notamment l’auteur de Renouer avec la France des Lumières (Calmann-Lévy, 2021).
Depuis la première élection d’Emmanuel Macron, la transformation du paysage politique français s’est accentuée. Dans les trois ans qui viennent, les élections mesureront les conséquences de cette évolution. Nous avons pensé qu’il fallait interroger des personnalités politiques, directement engagées dans la lutte électorale, sur les thèmes que leurs formations devraient désormais privilégier et défendre devant les électeurs. Nous nous adresserons, bien entendu, à des hommes politiques de droite, du centre et de gauche. Stéphane Le Foll a bien voulu répondre à notre enquête, et nous l’en remercions. Son article ouvre cette série.
Comme nos lecteurs le savent, il a été un dirigeant important du Parti socialiste : député européen, député de la Sarthe, ministre de l’Agriculture sous la présidence de François Hollande, dont il est proche, porte-parole du gouvernement d’avril 2014 à mai 2017, il a, en 2021, souhaité devenir le candidat socialiste à l’élection présidentielle, mais les participants à la primaire organisée par le parti lui ont préféré Anne Hidalgo. Il est maire du Mans depuis 2018, et il avait en 2021 publié aux éditions Calmann-Lévy un essai intitulé Renouer avec la France des Lumières (288 p.).
Dans l’article qui suit, il considère que la gauche française devrait être résolument « universaliste et internationaliste » – par internationaliste, il entend « européenne ».
Commentaire
La gauche est à la fin d’un cycle. Nous sommes passés de la lutte des classes à la peur du déclassement. Le progrès, jusque-là gage d’émancipation collective, a été remplacé par le besoin de résister individuellement au déclassement et à la comparaison immédiate avec autrui. D’une volonté d’organisation collective de nos vies nous sommes passés à un système d’individualisation. Éric Maurin, dans son essai La Peur du déclassement 1, avait précisé sa vision de ce phénomène :
Déclassement : le mot est aujourd’hui sur toutes les lèvres. Aujourd’hui omniprésente, la notion de déclassement traduit donc une réalité pressante et sensible, dont de nombreux travaux ont tenté récemment de prendre la mesure. Mais elle doit être distinguée d’un autre phénomène encore plus décisif : la peur du déclassement. Cette angoisse sourde, qui taraude un nombre croissant de Français, repose sur la conviction que personne n’est « à l’abri », qu’une épée de Damoclès pèse sur les salariés et leurs familles, que tout un chacun risque à tout moment de perdre son emploi, son salaire, ses prérogatives, en un mot son statut.
Sur cette base, je pense, contrairement à Éric Maurin, que la peur du déclassement n’est pas l’apanage des classes aisées mais qu’elle est, au contraire, le lot de ce que j’appelle les classes populaires insécurisées dans des sociétés postindustrielles individualisées.
En effet, les sentiments rationalisés face à certaines injustices ne trouvent plus de perspectives collectives de rétablissement mais se transforment en une dénonciation des inégalités entre citoyens. Ce sentiment de « perte de sens collectif » devient une identité en soi. « L’autre » devient un objet de comparaison, de convoitise et de frustration. La population qui travaille, paie des impôts, respecte les lois, se pense en « concurrence » avec ceux qui bénéficient d’aides sociales, du soutien de l’État, sans faire le « même effort ». Le sens de la solidarité s’efface au profit de l’individualisme et on perd peu à peu l’esprit d’un destin commun. C’est tout l’enjeu pour la gauche, qui doit revenir aux fondamentaux. L’un d’eux est le progrès, gage de réussite collective fondée sur des valeurs qui permettent à l’individu de dépasser son individualisme pour penser le collectif et faire nation.
Le sens à donner à nos sociétés aujourd’hui, c’est bien la défense au long terme d’un idéal social écologique et économique, de valeurs plus que de présupposés matérialistes du « chacun selon ses besoins ». Car rien dans ce domaine n’est acquis, figé ; comme l’avait dit Raymond Aron, tout est toujours en mouvement, comme une perpétuelle quête du mieux, de l’amélioration, qui pose d’ailleurs la question fondamentale de l’efficience du modèle de la démocratie libérale sur le long terme face aux modèles autoritaires qui contraignent plutôt que de convaincre. Ma conviction est que la force de nos démocraties, c’est celle de ses valeurs humanistes et universelles, c’est la liberté comme force propulsive pour l’envie, la créativité, la motivation et la curiosité.
La perte des classes populaires
La gauche se cherche ; et avec elle nos démocraties, qui voient monter dans l’abstention une part de plus en plus importante des populations désabusées qui ne croient plus en l’idée de progrès au sens social et inclusif du terme.
L’idée de classes avec une bourgeoisie homogène face à un prolétariat homogène est obsolète. Nos structures de production ne créent plus de classes mais des frontières entre « les catégories sécurisées » (bourgeois, personnes installées du monde urbain et périurbain, ouvriers et employés sous statut ou employés dans des grands groupes solides) et celles « insécurisées » (les travailleurs avec des statuts précaires, dans l’instabilité salariale, et ceux soumis à tous les aléas de nos économies interconnectées, sans structure de rattrapage sauf celles des filets de sécurité sociaux publics qu’ils partagent avec les plus pauvres).
La montée de l’individualisme a créé une fracture politique entre les couches ouvrières et populaires et les couches moyennes et supérieures. Mais elle a également créé une rupture plus grave entre ces « classes insécurisées » et les plus faibles, remettant parfois en cause le sens même de la solidarité. Car celui qui se trouve à la limite de la précarité ne veut pas basculer ; cette peur se matérialise aussi par le rejet du plus précaire. C’est bien cela qu’il faut combattre pour que la solidarité redevienne une évidence partagée par tous, pour éviter de tomber dans une société qui prône la charité comme aux États-Unis. On ne choisit pas « son pauvre », et la société doit être là pour chacun au cours de sa vie.
La croissance de l’après-Seconde Guerre mondiale avait structuré nos sociétés dans un progrès et un espoir qui permettaient de tirer tout le monde vers le haut. Tout était possible dans une cohérence politique et sociale où les études étaient un moyen de la mobilité sociale, mais pas le seul. Il existait d’autres moyens que la norme académique. La progression et l’émancipation passaient aussi par les entreprises, où l’on travaillait de génération en génération en gravissant les échelons. Ou encore par l’exode rural, moteur d’une quête d’un avenir meilleur vers les villes. Enfin, la fonction publique permettait d’acquérir un statut social et une sécurité de l’emploi même quand le chômage n’existait pratiquement pas.
Mai 1968 a vu surgir dans ce vaste mouvement socio-économique l’explosion de la liberté individuelle, ouvrant la voie au « moi » en larguant les carcans religieux, institutionnels, culturels et politiques. Dans le monde rural, le curé, le médecin, le gendarme et l’instituteur ont peu à peu disparu comme références sociales. Dans le monde industrialisé et très structuré des grandes entreprises, les masses encadrées par des syndicats et partis politiques de gauche marxistes qui sécurisaient tout le monde dans une croyance positive de l’avenir se sont effritées, voire ont disparu. L’arrivée du tertiaire, de l’économie postindustrielle et du numérique a fragmenté les structures de production et individualisé continûment le rapport au travail.
Ainsi, au fil du temps, la classe populaire a quitté le camp de la gauche. C’est un bouleversement sans précédent dont les conséquences politiques se mesureront avec le temps, produisant la montée continue du Front national jusqu’au choc de 2002 et l’échec de Lionel Jospin à être au second tour de l’élection présidentielle. Pourtant, son gouvernement avait un bilan d’une gauche traditionnelle à faire pâlir aujourd’hui un Insoumis en colère. Le schisme politique qui s’était créé est apparu ce soir-là, montrant à la télévision des mains sur les visages, les cris et les pleurs des militants de la cause. Les victoires suivantes de la gauche aux régionales et aux européennes, avec l’échec et l’extrême droitisation de Nicolas Sarkozy, ont étouffé les causes de cette rupture, et la victoire de 2012 n’a jamais été précédée d’une analyse du bouleversement à l’œuvre. L’échec de François Hollande et la victoire d’Emmanuel Macron face à Marine Le Pen signent la faillite de la gauche. Dès ce moment-là, ne cesse de se creuser le fossé entre ceux qui ont su se construire de nouvelles sécurités individuelles mais aussi de nouvelles relations interpersonnelles dans le monde urbain, voire « rurbanisé », et les autres.
Les couches populaires, ouvrières mais aussi celles des quartiers, deviennent livrées à elles-mêmes dans un effondrement des structures sociales. Car la société libérale postindustrielle, celle de la consommation de masse individualisée, n’est pas facile pour toutes ces populations en perte de repères, à la fois pour acquérir les codes culturels individuels, éviter les pièges du surendettement, cautériser les plaies des échecs scolaires, des échecs à trouver un emploi, de la perte de projection dans l’avenir et de la perte au bout du rapport à autrui.
Comment en sommes-nous arrivés là, quelles sont les raisons objectives du mal-être des couches populaires et moyennes ?
De la lutte de classes à la lutte contre le déclassement
Contrairement à ce que pense une grande partie de la gauche, le déclassement est une forme aboutie de rationalité chez ceux qui ne voient plus pour eux et leurs enfants de progrès possible, qui ne perçoivent plus l’idée de progrès collectif dans une dynamique de classe. Il n’existe plus de lutte des classes et de classes au sens marxiste ; elles se sont transformées. La fragmentation sociale existe partout où se sont effondrées des industries qui structuraient les territoires, les industries minières, de sidérurgie, d’automobile et une forme d’agriculture avec la fin des paysans. Cet effondrement des structures sociales et économiques entraîne une perte de richesse dans ces territoires qui ne peut pas être compensée à court terme par des mutations des types de production qui laissent les abandonnés des anciennes structures collectives du travail sur le bord de la route. Leur effort individuel d’adaptation étant hors de portée, ces personnes perdent alors leurs béquilles pour tenir debout.
Quant aux quartiers de nos villes, c’est la pauvreté endémique associée à l’impossible mixité qui rendent les populations liées entre elles par leur niveau social, leurs communautés et maintenant leur religion. Pire, le quartier devient l’espace d’exercice d’un capitalisme sauvage qui s’installe culturellement avec le trafic de stupéfiants, la réussite facile par la transgression des règles et la violence. Pour s’en sortir, il faut partir et laisser les plus fragiles et les nouveaux arrivants dans des vagues perpétuelles de pauvreté. Seuls les services publics, dont l’école et les services de proximité, offrent, avec le tissu associatif, un lien avec le reste de la société et une porte de sortie vers le mieux. On n’insiste pas assez : cela produit de formidables réussites individuelles, même si elles restent marginales.
Tous ces processus entraînent un sentiment d’impossible issue pour de nombreux citoyens, qui cherchent pourtant à s’accrocher, à créer des relations positives et vectrices de liens pour sortir de l’isolement. Car il existe toujours, contrairement à ce que pensent Thomas Piketty et Julia Cagé, une identité culturelle sous-jacente profonde à toutes structures sociales de production et de revenus. Il faut la raviver, l’entretenir lorsqu’elle joue son rôle de ciment social, de partage. Ainsi, pour les passionnés de foot du RC Lens, « Les Corons » de Pierre Bachelet forge l’identité du club mais, plus fondamentalement, celle revendiquée du territoire, de sa mémoire magnifiée de la mine et celle de la souffrance et de la fierté des mineurs qui est transposée, projetée, chantée dans le stade.
On pourrait trouver partout ces formes d’expression identitaire sous-jacente dans les territoires. Je pense aussi à Clermont-Ferrand et à son attachement à Michelin, mêlant culture ouvrière, voire agricole, et culture régionale ; des exemples sont aussi présents dans les quartiers, la ville ayant elle-même sa propre dynamique identitaire car, comme l’a écrit Braudel, « elle est domination ».
C’est l’individualisme, sans culture et sans identité, qui est mortifère. En passant ainsi de la lutte des classes à la logique du déclassement, on passe d’une logique collective d’espoir à une logique individuelle pour s’en sortir ; d’une démarche collective propulsive à celle de la comparaison à autrui qui est délétère. Les couches populaires ont ainsi rompu profondément avec le schéma classique de la gauche dans sa capacité à porter l’espoir de changer la vie. Cette boucle de la désespérance est d’autant plus forte et effective que la gauche s’agite jusqu’à se perdre dans la contestation la plus radicale, brutale pour trouver grâce dans une colère mimée dans la rue ou à l’Assemblée nationale aux yeux de ceux qui pourtant ne la regardent plus. Cette course à la colère a été illustrée à de multiples reprises par Jean-Luc Mélenchon, qui indiquait pendant les émeutes les lieux « à casser » et ceux « à ne pas casser », ainsi que par Fabien Roussel, qui lui a emboîté le pas en invitant les Français à prendre d’assaut les préfectures. Qu’est-ce qui leur prend pour agir ainsi ? Ne comprennent-ils pas que ce que les couches populaires veulent, c’est la réussite, la stabilité et la reconnaissance ? Ne perçoivent-ils pas qu’une révolution, même annoncée citoyenne, est pour elles dépassée et décalée ?
Derrière ces postures se cache l’idée d’attirer les « fâchés fascisés ». Ce choix est en train, dans cette course au pugilat, de faire fuir un électorat modéré qui, jusqu’alors, n’était ni trop « fascisé » ni trop « fâché », mais qui a peur à juste raison du chaos et qui va chercher, comme l’a montré notre histoire, à chaque occasion l’autorité et l’ordre. C’est la logique de cette époque : à force de renoncer à l’affirmation de nos valeurs démocratiques, on se rapproche cruellement de ceux qui, un jour, nous les retireront. Cela est d’autant plus vrai que notre société vieillit et que le nombre de retraités augmente avec la recherche de stabilité comme priorité. Preuve s’il en est, c’est cet électorat plus âgé qui bascule, comme le confirment les sondages en ce moment, vers le Rassemblement national. Bravo à la gauche des « excités » qui, si elle continue, sera directement responsable de la facilité donnée à Marine Le Pen d’être, par contraste, en situation d’acquérir la respectabilité politique. D’autant que la droite républicaine se laisse aller aux débordements d’un duo Ciotti-Wauquiez engagé dans une fuite en avant populiste.
Ce retour à l’enfermement dans la colère et la contestation conduit la gauche actuelle à réactiver la vieille ligne marxiste. Cette gauche du pugilat copie la logique du Parti communiste entre les deux guerres. Ce qui m’a frappé et étonné, ce sont les mots de Jean-Luc Mélenchon en réaction à la demande d’appel au calme lors des émeutes : « Nous n’avons pas à recevoir de leçons des chiens de garde. » Cette référence à l’essai de Paul Nizan, qui dénonçait les intellectuels personnalistes et humanistes de l’époque par le terme « chiens de garde », est pour le moins déconcertante… La ligne était en substance à l’époque que seul le communisme luttait contre le fascisme. Cette ligne s’est appliquée avec des formules fameuses de Maurice Thorez comme « Il n’y a pas de différence de nature entre la démocratie bourgeoise et le fascisme. Ce sont deux formes de dictature du Capital », et ce jusqu’au changement de ligne après l’arrivée d’Hitler et les émeutes factieuses de février 1934 en France. Cela a conduit le Front populaire à sauver la République pour quelque temps. La ligne d’avant 1934 est exactement celle qu’a choisie Jean-Luc Mélenchon dans son texte sur les émeutes. Sa référence au « front populaire » est alors une imposture. On l’oublie, le Front populaire a été le résultat d’un changement de ligne, et on pourrait l’assimiler aujourd’hui à une alliance de gauche et du centre gauche, chacun s’étant compté au premier tour des élections avec un désistement efficace au second. À l’époque, la troisième force avec le Parti communiste et la SFIO de Blum était celle des Radicaux de Daladier et de Chautemps, alliés depuis la fin du cartel des gauches à la droite républicaine.
Le renouveau du socialisme démocratique
C’est pourquoi il faut renouer avec un socialisme démocratique capable de créer une alliance plus large sur deux points essentiels. La question de la sécurité est le premier, bien entendu, à la fois parce que les embardées anti-police sont inaudibles – et pas seulement pour les couches populaires – et parce que des sécurités nouvelles doivent être apportées dans la vie autour du travail en abandonnant les vieilles lunes de la réduction du temps (même si on ne reviendra pas sur les 35 heures de travail) et de la logique de l’aliénation liée au travail. Ainsi, contrairement à ce que pensent l’extrême droite et les nationalistes, ce n’est pas le retour aux frontières qui va nous sécuriser ; c’est bien la structuration des organisations autour de l’entreprise et du travail qui est garante de ces sécurités recherchées. Il faut retrouver ce qui existait dans la structuration économique et sociale, ne plus se contenter de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises quand on a perdu tous les liens que produisaient les comités d’entreprises. Il faut pour cela penser la politique non plus comme celle de l’emploi mais comme celle de la place du travail dans la part d’identité qu’on doit à chacun pour se situer par rapport aux autres. Il faut réhabiliter à ce titre un engagement plus fort des entreprises dans le cadre des branches pour restructurer une alliance ouvrière et syndicale plus dynamique en termes sociaux, de formation, d’emploi et d’écologie et de sentiment d’appartenance et d’encadrement. Certaines branches jouent déjà en partie ce rôle ; il faut l’amplifier.
L’individualisme de nos sociétés
L’ouvrage collectif Les Origines du populisme 2, auquel a participé Daniel Cohen, montre bien que le vote populiste des couches populaires traduit une quasi-indifférence à la question de la redistribution en même temps qu’il est le résultat de la faiblesse des relations interpersonnelles. La question des revenus est toujours la plus explicite, le déterminant majeur. Plus les gens sont riches, plus ils tendent vers l’individualisation, soit une forme d’autonomie individuelle qui accepte l’ouverture à autrui, à la différence. Ainsi, comme l’a montré une vaste étude européenne, plus on vit dans des classes aisées et un pays sécularisé, plus on est dans l’individualisation et plus les immigrants adoptent les valeurs du pays d’accueil. Ces deux points devraient pouvoir rassurer les politiques de gauche sur la voie à suivre en s’appuyant sur les valeurs laïques et sur la capacité à intégrer. Dans cette même veine, Pierre Bréchon, dans un article récent, rappelle que la sécularisation, la croissance économique et l’éducation sont les facteurs primordiaux de l’individualisation et les remparts au repli sur soi face à la perte de relations interpersonnelles.
Il y a là une leçon à tirer pour la gauche et le socialisme, en réaffirmant les valeurs des Lumières et celle de la laïcité, ces valeurs qui font que l’individu, sa liberté et son autonomie sont compatibles avec un commun, au présent et à l’avenir, parce que partagé par tous sans distinction. Cette idéologie des valeurs se fonde non pas sur le déterminisme marxiste mais sur l’alliance entre démocratie et modèle social, et en y mêlant à présent l’ambition écologique. Concourent à ce corpus de valeurs la promotion du dialogue, du compromis ; la défense de l’éducation, de la culture et de la science ; la valorisation d’un travail reconnu pour chacun et qui participe à la construction de l’avenir.
Revenir au sens de la valeur travail
La fin des classes sociales n’a pas fait disparaître le besoin de reconnaissance par le travail. La notion de mérite a été mal comprise par la gauche. Deux exemples historiques sont frappants. D’une part le rapport au travail sous l’ère Jospin, puis son traitement par Nicolas Sarkozy lors de sa campagne présidentielle de 2007. L’un a suivi la ligne traditionnelle de la gauche sans comprendre les attentes des classes populaires et moyennes ; l’autre s’est emparé du « travail » pour faire revivre le clivage entre ceux qui « travaillent dur » et les autres. Le premier échoua à faire comprendre sa stratégie ; le second gagna la présidentielle sur le slogan « Travailler plus pour gagner plus ».
Je me souviens ainsi de l’échec de Lionel Jospin en 2002 et de l’arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour de l’élection présidentielle malgré un bilan social important. La gauche a permis de réorganiser le temps de travail en faveur des cadres et des « classes sécurisées » en oubliant que, pour les employés et les classes populaires, cela aurait comme résultat de faire baisser l’évolution de leurs rémunérations. Je m’en suis rendu compte, lors du début de ma campagne législative dans la Sarthe en 2002, par l’interpellation sur un marché d’un ouvrier d’un abattoir de volaille, furieux d’avoir perdu ses heures supplémentaires et d’être astreint de surcroît à l’annualisation de son temps de travail.
La campagne de Nicolas Sarkozy avait fait mouche sur cette idée du travail et de son individualisme avec la reconnaissance du mérite. En 2007, le vote FN baissa significativement dans toutes les régions ouvrières. C’est une preuve factuelle de cette fracture avec les couches dites populaires. La crise financière a rappelé à la droite que les heures supplémentaires sont distribuées par les entreprises et ce slogan est devenu une promesse déçue. En 2012, nous l’avons supprimée pour deux raisons rationnelles : elle profitait une fois de plus aux cadres, aux entreprises, plutôt qu’aux ouvriers, et dans une phase de montée du chômage elle était devenue coûteuse. Mais, au fond, ce qui comptait, c’était le lien entre les heures supplémentaires et le travail, individualisant la rémunération et valorisant le mérite de chacun.
Cela s’inscrit pleinement dans la logique rationnelle du refus du déclassement. D’autant que les dernières études liées au vieillissement de nos sociétés ajoutent à cela que la richesse acquise par le travail s’efface devant celle de l’héritage et de la rente. « Le travail ne paie plus » : ce slogan récent de la Première ministre Élisabeth Borne renforce le sentiment de déclassement de ceux qui ont peu, voire rien à léguer à leurs enfants et petits-enfants. Le schisme social français devient alors béant. Rien, absolument rien ne pourrait justifier dans ce cadre de nouveaux avantages fiscaux sur l’héritage, comme une partie de la majorité l’envisage.
En tout état de cause, l’incapacité de la gauche à se repenser la conduit à se tromper et à rester sur les chemins dangereux de l’incompréhension vis-à-vis des couches populaires, qui estiment aujourd’hui que leur pari intuitif sur l’avenir dépend pour l’essentiel d’elles-mêmes. Ce sentiment rationalise leur choix politique, voire leur abandon du débat démocratique avec la montée de l’abstention. Dans ce vide qui s’installe, tout ce qui perturbe la vie quotidienne en termes d’insécurité, en banlieue mais partout ailleurs, tout ce qui fait percevoir l’immigration comme perturbation et concurrence, au sens propre du terme, renvoie immédiatement à un ressenti négatif en particulier vis-à-vis de la puissance publique, de l’État, voire des collectivités, et de manière plus globale favorise le rejet de l’autre. Le mouvement des Gilets jaunes a été une poussée de fièvre liée à une taxe qui était vécue rationnellement comme un cran de plus dans la logique du déclassement ; c’est un fait incontestable.
Le pire pour la gauche est alors de larguer les amarres des valeurs républicaines en cherchant à segmenter les électorats par l’essentialisme des causes, de faire le choix par principe de la défense des minorités au détriment de ce qui émancipe et de ce qui rassemble. Délaisser les valeurs républicaines, c’est affaiblir le rôle fondamental de l’universel, au profit du particulier et de l’identitaire. Il faut tenir à ce stade une promesse fraternelle, car la fraternité, et en elle la laïcité, dépassent tous les segments essentialistes, sources de haine, de colère, de racisme et d’antisémitisme. On retrouve le même égarement idéologique avec la question écologique : les classes populaires ne sont pas contre l’écologie. Ce jugement presque moral d’une partie des écologistes est une impasse pour la gauche car il faut penser l’écologie comme un moyen de contribuer à la fois à la lutte contre le réchauffement climatique et au progrès social.
La question écologique face à la crainte du déclassement
Cette écologie politique de la décroissance produit sa propre radicalité, qui se fonde sur une forme de repentance après les progrès de nos sociétés industrielles car nous devons en payer collectivement le prix comme des cigales insouciantes ayant dansé pendant des années et qui se trouvent dépourvues depuis « le chaud est venu ». La punition est collective mais les « fourmis » estiment n’avoir pas assez, ne comprennent pas le sens du choix de la sobriété, considérant qu’elles ne participent pas à la fête. Le radicalisme de certains écologistes peut aller jusqu’à vouloir remettre en cause la démocratie pour imposer un changement de cap brutal, en jouant sur la désobéissance civile et européenne. S’y ajoute avec l’écoféminisme une touche perturbante supplémentaire. Le patriarcat serait la cause de tous les maux, la prédation étant chez l’homme la pulsion primitive qui mène à la perte de l’humanité.
Ce qu’il faut encore une fois, c’est se placer au niveau des valeurs universelles : c’est-à-dire la lutte pour obtenir l’égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre les violences faites aux femmes, soit les valeurs défendues par le féminisme de Beauvoir qui militait pour qu’au bout il y ait le respect, l’altérité dans l’égalité sans vengeance et sans repentance. Le barbecue est-il « machiste », comme le prétend Sandrine Rousseau ? Non, il est d’abord un outil de convivialité, de lien interpersonnel et à ce titre utile. Les couches populaires ont leurs codes ; ils se sont créés dans le temps, ils doivent évoluer, mais toute culture populaire est respectable tant qu’elle produit du lien à autrui. Dénigrer cette culture et les liens interpersonnels qui subsistent, c’est mépriser au nom d’une lecture provocatrice les couches populaires.
Fabien Roussel ou, dans une autre mesure, François Ruffin essayent de corriger ces biais en revendiquant pour le premier d’aimer la viande et d’aimer manger, pour le second d’avoir une approche plus lucide sur la sécurité, mais sans en tirer de grandes conclusions en termes de politique économique et sociale. Sauf à prendre le risque, comme aux Pays-Bas, en Slovaquie ou récemment aux États-Unis avec Trump, qu’en réaction les couches populaires ne durcissent leurs votes et basculent définitivement dans le radical, l’isolationnisme, le rejet des autres, le refus de penser que les choses sont liées à l’échelle de la planète et qu’entre la fin du mois et la fin du monde il n’y aurait aucune voie possible. Il faut changer notre lecture des choses.
L’enjeu pour la gauche est de fonder un projet pour faire nation autour d’un collectif retrouvé face à l’individualisme de notre société. D’une certaine manière, lutter contre un mal naturel qui, au début, laisse à penser que chacun serait plus « autonome », mais qui, ensuite, se referme sur les individus qui finissent par se sentir seuls, incompris et sans repères. La question écologique met en lumière cette transition malsaine qui s’est opérée dans notre société. Les « classes insécurisées » n’ont pas la marge de manœuvre pour faire les efforts demandés par une partie des écologistes. Il y a donc un enjeu économique pour l’avenir et pour gagner la bataille de la lutte contre le réchauffement climatique. Il faut passer d’une surcroissance à une croissance sûre, capable d’apporter le progrès pour tous.
Investir pour croître et pour financer notre modèle social
L’enjeu de l’investissement est la seule manière de combiner la transition énergétique avec l’amélioration du revenu disponible des ménages. C’est un débat crucial qui anime la gauche tentée par la généralisation de la gratuité des choses, la redistribution généreuse, mais qui manque alors l’essentiel pour changer en profondeur notre modèle de développement, à savoir le rôle essentiel de l’investissement.
Pour changer nos énergies, il faut investir dans la recherche pour innover, pour améliorer le revenu disponible et réduire les charges des ménages avec l’isolation de tous les bâtiments ; investir pour améliorer la compétitivité des entreprises ; investir dans des infrastructures nouvelles pour des mobilités décarbonées. Pour cela, il faut mobiliser l’épargne, lutter fiscalement contre la rente, dégager des recettes supplémentaires, orienter la finance qui ne peut pas chercher l’optimisation privée de ses placements sans tenir compte de leurs impacts sur l’environnement et sur le réchauffement climatique. Elle doit prioriser l’investissement vert et, pour y parvenir, il faut modifier les règles prudentielles et mettre en place une taxe sur les flux financiers plutôt que la taxe carbone aux frontières. Tout doit se focaliser sur cet enjeu et c’est ici, au service de l’investissement, que l’Europe doit jouer tout son rôle. Car un principe simple s’applique si l’on ne se concentre que sur la redistribution : plus elle est généreuse, moins son impact sur le moyen terme est soutenable.
Ainsi, l’école est un énorme défi. Elle est elle aussi un investissement pour l’avenir de nos enfants et l’échec scolaire est une forme de déclassement. Il s’agit en l’occurrence de ne pas se perdre dans les moyens mais d’assurer l’objectif de faciliter la réussite scolaire en accompagnant la vie de l’enfant sur le temps scolaire et périscolaire, dans un fonctionnement décentralisé avec les collectivités locales. La France insoumise proposait ainsi la gratuité totale des frais scolaires pour 7 milliards d’euros, obérant le long terme dans un coût de fonctionnement énorme qui doit être, au contraire, investi pour lutter contre les causes de l’échec scolaire.
Même constat pour les transports : investir dans du matériel moderne, c’est assurer l’amélioration de l’offre sur le long terme en améliorant les coûts de fonctionnement et donc le prix du transport collectif, car c’est l’objectif primordial. Les Gilets jaunes, je le rappelle, se sont mobilisés contre une taxe, pas pour une redistribution généreuse. Ils étaient aussi favorables à un retour de l’impôt sur la fortune par souci d’égalité, ce qui est juste dans la mesure où le décile des plus riches est celui qui pollue le plus. Les classes populaires, dans leur lutte contre le déclassement, ne se focalisent pas sur la redistribution ; elles veulent être reconnues pour ce qu’elles sont : une part entière de notre pays avec une aspiration individuelle à exister.
Reconnaître et rémunérer la valeur sociale des métiers
La place du travail et sa valeur individuelle rémunératrice doivent être associées à la valeur sociale. Ce que l’on a appelé les première et deuxième lignes pendant la pandémie donne à ces travailleurs de l’ombre une valeur sociale qui n’est pas reconnue par le salaire, surtout quand on est à temps partiel. Il faut reconnaître dans beaucoup de métiers cette valeur sociale collective qui n’est jamais prise en compte par le salaire. Il faut pour cela transformer la prime d’activité, qui ne peut plus être une allocation versée par la Caisse d’allocations familiales ; elle doit devenir la prime du travail et être versée sur la feuille de paie, ce qui est maintenant rendu possible grâce au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Cette part de prime est une valeur monétaire à donner à la valeur sociale de certains métiers peu attrayants et pourtant indispensables à nos sociétés.
Cette nouveauté doit s’accompagner d’une remise à plat des cotisations sociales, qui doivent être revues et, comme le proposent certains députés, supprimées au-delà de 2,5 SMIC. La « smicarisation » des salaires pose en soi une question : elle renvoie là encore pour certains non pas à un progrès mais à une forme de déclassement frustrant et démotivant, en particulier pour ceux qui ont fait des études. Il faut revoir la question fondamentale de la place du travail dans nos sociétés. Le SMIC comme les salaires doivent faire l’objet de négociations régulières, et le principe, remis à l’ordre du jour par le gouvernement, d’une conférence sociale doit conduire à une conférence biannuelle posée comme un principe intangible de notre démocratie sociale pour arbitrer les parts salariales et sociales des rémunérations entre syndicats, patronat et État, dans le but de créer une dynamique inclusive et solidaire.
Dans ce paradigme travail-salaire-prime, le basculement du crédit d’impôt compétitivité emploi vers la baisse des cotisations sociales a été une erreur. L’inflation et l’augmentation des salaires représentent un coût des exonérations pour l’État qui est devenu exorbitant et qui ne cesse d’augmenter. En supprimant une partie des exonérations, on pourrait réinvestir dans la prime pour le travail et vers un crédit d’impôt énergie et/ou un « surinvestissement vert » pour les entreprises afin de stimuler la compétitivité par l’efficacité énergétique des entreprises.
Les branches en particulier de l’industrie et de l’agriculture doivent devenir des espaces nouveaux de dialogue patronat-syndicat, de recherche et d’innovation pour la transition énergétique, et être un facteur de compétitivité, de formation et de solidarité. C’est un grand changement à opérer pour faire du Conseil économique et social l’espace stratégique d’un nouveau plan français de croissance durable regroupant les branches professionnelles, à condition d’en réduire le nombre et d’identifier leur rôle auprès des salariés pour construire des sécurités collectives.
Internationalisme et Europe
Nous en sommes arrivés à un moment de notre histoire où nous devons à nouveau revendiquer des valeurs face aux idées reçues venues de la gauche, à la montée de l’extrême droite et à la tripartition de la vie politique. Benda condamnait l’attitude de ceux qui abandonnaient les valeurs par idéologie ou par circonstances dans La Trahison des clercs ; Jaurès anticipait et nous incitait à se mettre « à l’abri des huées fanatiques » ; quant à François Mitterrand, il nous invitait à mettre « le môle du socialisme français à l’abri du flot compact des idées reçues ».
Cette question des valeurs est au cœur de l’histoire de France, de son conflit entre conservateurs et progressistes, républicains et monarchistes, entre la gauche et la droite. Elle est aussi cruciale chez les modérés qui font vœu de tempérance même dans les tempêtes mais qui doivent, s’ils veulent exister dans ces moments paroxystiques, être puissamment visionnaires, arcboutés sur la défense des valeurs qui fondent l’universel et l’humanité. Car, à chaque fois qu’on laisse disparaître les valeurs à cause du poids des difficultés du présent, le pire est à venir. Je pense que les vents mauvais se sont à nouveau levés, et il faut être vigilants et fermes sur ces valeurs républicaines, universelles et démocratiques. Sinon les adeptes du retour à l’autoritarisme, au nationalisme, à droite et à l’extrême droite, les défenseurs de la rupture, de la colère, de la lutte des classes, des revendications identitaires, communautaires, voire religieuses, à gauche et à l’extrême gauche, seront les maîtres du jeu.
Ces passions sont aujourd’hui attisées aux périphéries, à gauche comme à droite, et elles sont dominantes dans les débats, mais sans avenir car sans valeurs humanistes profondes. Ces dernières sont pourtant les seules capables d’apporter un équilibre entre la liberté et l’égalité, les seules capables de défendre la fraternité. L’équilibre est toujours fragile entre l’individu, le commun et le collectif, entre le moi et le « nous », entre l’individualisme et l’individualisation, c’est-à-dire entre l’autonomie individuelle et le repli sur soi, entre l’existentialisme et l’essentialisme, entre la déconstruction, la vengeance et la destruction, enfin entre la démocratie et le totalitarisme.
Toutes ces alternatives philosophiques et politiques sont au cœur des débats d’aujourd’hui au sein de nos sociétés et à l’échelle internationale. Le monde déraille : Ukraine, Israël, Palestine, Iran, Arménie, Afghanistan, Chine, Afrique sahélienne… Le bouleversement mondial des valeurs, c’est la victoire des belliqueux sur les pacifistes, de la vengeance par la force sur le compromis, de l’autorité d’un seul sur la délibération collective, de la force des minorités agissantes sur la majorité passive, des extrémistes qui agitent toujours en même temps les peurs et la violence. D’autres systèmes de valeurs, comme le montrent aujourd’hui la Russie de Poutine, la Chine ou l’Iran, cherchent à se faire une place dans le monde.
De la fin de la mondialisation régulée à la montée de la concurrence des nations les unes contre les autres, de la démondialisation aux nationalismes, il n’y a plus qu’un pas à franchir pour basculer à nouveau dans une spirale infernale. L’Europe, et son projet post-nationaliste après deux guerres mondiales et des millions de morts, connaît à nouveau un moment de doute existentiel ; mais, plus grave, son modèle et son corpus de valeurs sont contestés à l’intérieur du continent. J’ai accueilli avec soulagement l’élection en Pologne de Donald Tusk, qui est un signe rassurant et qui ouvre une vraie perspective constructive pour l’Europe.
Être de gauche a toujours impliqué d’être internationaliste, et être internationaliste, c’est être européen. C’est vouloir embrasser l’humanité dans sa croisière sur terre en restant ouvert, à l’écoute, tout en cherchant à conjurer ses pulsions mortelles.
Forts sur la défense des valeurs, intangibles sur l’ouverture et l’écoute des autres, c’est ainsi que nous devons nous dresser, hommes et femmes de la gauche mais bien au-delà, en retenant toujours la leçon de toutes nos histoires malheureuses et en pensant aux plus grands, ceux qui, au nom de l’universalité, ont perdu la vie pour sauver l’humanité.
Notes et références
-
É. Maurin, La Peur du déclassement. Une sociologie des récessions, Seuil, 2009.
-
Algan et al., Les Origines du populisme. Enquête sur un schisme politique et social, Seuil, « La République des idées », 2019.
Article paru dans la revue « Commentaire » Numéro 184 | hiver 2023 – 2024